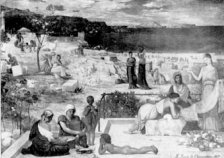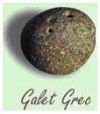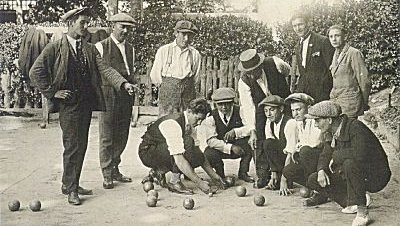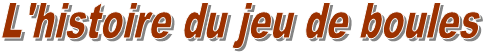

La Préhistoire
Le
jeu de boules, tout comme le jeu d’osselets semble remonter à
l’aube de l’humanité. Dans un premier temps est né
le geste du lancer, lié, de toute évidence, à la
nécessité de chasser.
De l’entraînement à cette activité pour le moins
vitale nos ancêtres firent rapidement un jeu, lequel évolua
sous des formes diverses au long des millénaires.
L’on peut raisonnablement penser que l’homme de la préhistoire
jeta donc des pierres. Mais les premières découvertes d’objets
plus ou moins sphériques assimilables à des boules ont été
faites à Catal Huyuc, ville anatolienne d’Asie Mineure. Ces
sphères de pierre, dont l’usage spécifique nous reste
malheureusement inconnu, datent de 5000 à 6000 avant J-C.